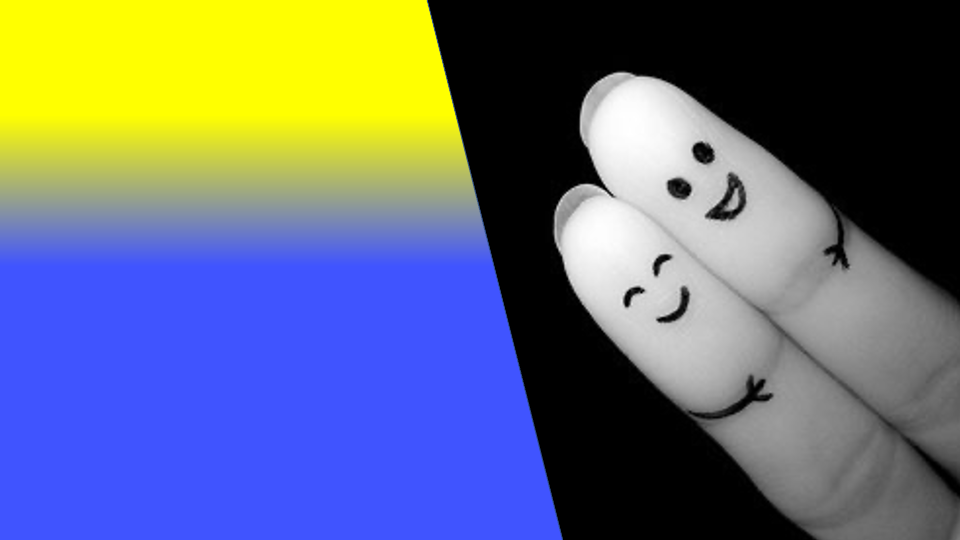
Reporting ESG (Environnement – Social – Gouvernance)
Il existe plusieurs approches de reporting extra-financier ESG dont la plus répandue est celle des standards GRI « Global reporting initiative » qui propose un référentiel et des indicateurs de performance quantitatifs et/ou qualitatifs. Il s’agit d’un instrument facultatif pour les entreprises.
En réponse au besoin de normalisation et de standardisation, il existe aujourd’hui deux cadres normatifs en cours de développement, tous deux menés en collaboration avec la GRI.
Les normes ESRS de l’UE :
Les normes ESRS (European sustainability reporting standards) sont développées en exécution de la Directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Elles visent à rendre la divulgation d’informations extra-financières obligatoire pour les entreprises européennes d’une certaine envergure dès 2024 puis ultérieurement également pour les PME européennes cotées ainsi que les entreprises hors UE réalisant un certain chiffre d’affaire en UE.
A terme, d’ici 2028, ce sont plus de 50’000 entreprises qui y seront soumises. Ce reporting extra-financier doit figurer dans le même rapport que les informations financières.
Les normes de l’ISSB :
Parallèlement, l’ISSB (International Sustainability Standards Bord) a été constitué par l’IFRS (International Financial Reporting Standards) pour proposer des normes de reporting extra-financier de référence mondiale.
Bien que l’IFRS soit une initiative privée, ses normes comptables générales ont été rendues obligatoires dans plus de 120 juridictions dans le monde pour les entreprises soumises à l’exigence de publication des comptes, telles les sociétés cotées. L’ISSB vise une couverture similaire pour ses normes extra-financières.

Elles prévoient un reporting axé uniquement sur la matérialité financière, à destination prioritaire des investisseurs.

Normes ESRS:
Elles intègrent à la fois la matérialité financière, sous l’angle du reporting sur les risques et opportunités que représentent les éléments extra financiers, mais également la matérialité d’impact, avec les exigences de transparence sur les impacts que l’entreprise exerce sur l’environnement ou sur la société.
L’UE retient donc une approche de double matérialité.
Deux approches qui peuvent se rejoindre
Si les deux approches semblent opposées, la matérialité d’impact peut à terme rejoindre la matérialité financière, par exemple lorsque l’entreprise contribue par son activité à l’aggravation des risques auxquels elle est exposée.
Se dirige-t-on vers un reporting financier ESG?
Des tentatives existent.
On peut par exemple citer l’EP&L, compte de résultat environnemental, élaboré par le groupe Kering, qui propose une valorisation monétaire de l’empreinte environnementale de l’entreprise. L’empreinte est mesurée sur l’ensemble de sa chaîne de valeur au regard de 6 critères tels que par exemple les émissions de CO2, la consommation d’eau ou l’utilisation des sols. Des facteurs de monétarisation sont ensuite appliqués aux indicateurs mesurés. A noter que cette méthodologie, au format libre, est entièrement accessible en open-source.
On peut également mentionner le modèle de comptabilité CARE (Comptabilité Adaptée au Renouvellement de l’Environnement), développé en 2012, par Jacques Richard et Alexandre Rambaud, chercheurs associés à l’Université Paris-Dauphine, qui intègre le capital naturel et le capital humain dans la comptabilité générale, au même titre que le capital financier. Le profit est ensuite déterminé après la mise en œuvre de mesures de préservation des différents capitaux et leur amortissement, sans substitution entre eux. Cette méthodologie utilise le format des états financiers traditionnels et est également accessible librement.
Ces modèles, en expérimentation et en développement continus, se heurtent à des difficultés pratiques de choix de facteurs de monétarisation ou de nécessité d’un consensus scientifique pour la définition des indicateurs de stocks des capitaux environnementaux ou humains.